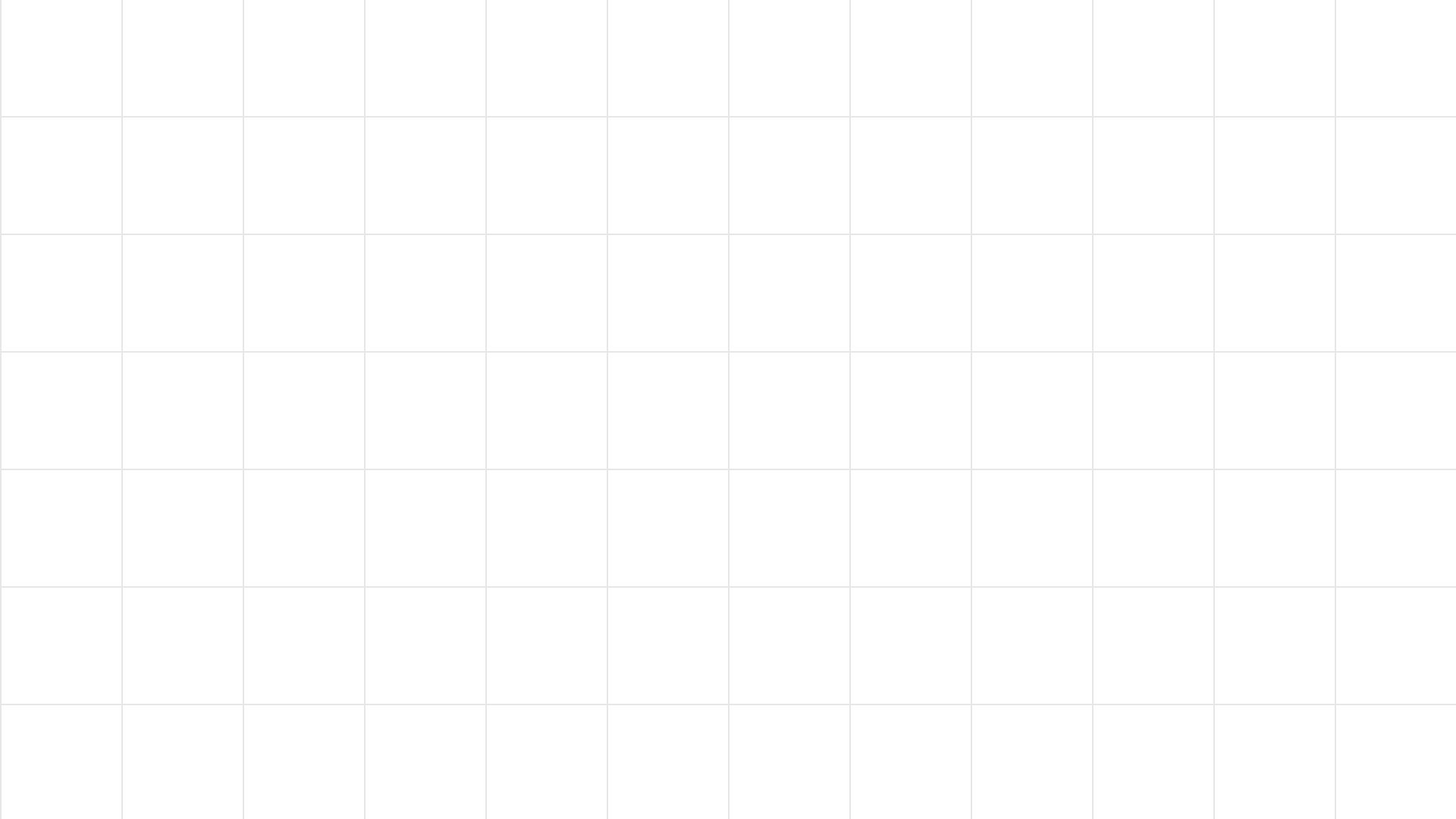Qu’est-ce qu’une dette écologique ?
Une vision globale du vivant
Dans la méthodologie C.A.R.E., la dette écologique inclut à la fois le capital environnemental et le capital humain. Pourquoi ? Parce que le vivant est un tout, et les humains en font pleinement partie. Ainsi, la dette écologique couvre les dimensions sociales et environnementales, reflétant l’impact global des activités d’une organisation.
Définition comptable
La dette écologique correspond au manque de préservation des capitaux naturels et humains nécessaires pour maintenir un bon état écologique.
Au bilan des états financiers, c’est ce qu’on appelle le passif.
Elle représente les coûts liés aux impacts négatifs des activités de l’organisation sur les écosystèmes et les populations.
Comment est-elle calculée ?
La dette écologique est mesurée en fonction des seuils définissant un bon état écologique. Prenons un exemple : une entreprise forestière qui exploite plus de bois qu’il n’en repousse naturellement génère une dette écologique. Cette dette est évaluée en chiffrant les coûts nécessaires pour replanter les arbres et restaurer les écosystèmes affectés.
Un outil de responsabilisation
La dette écologique n’est pas seulement une mesure : c’est un levier pour responsabiliser les organisations. Elle permet de quantifier de manière concrète les impacts environnementaux et sociaux, incitant ainsi à adopter des stratégies de régénération. En intégrant ces enjeux dans leur gouvernance financière, les organisations alignent leurs pratiques sur une économie véritablement durable.
Pourquoi maintenir un seuil de bon état écologique ?
Maintenir un seuil de bon état écologique est essentiel pour garantir la pérennité des écosystèmes, des ressources naturelles et des communautés humaines qui en dépendent.
Voici les principales raisons :
1. Préserver le capital naturel et humain
Les seuils de bon état écologique assurent que les capitaux environnementaux et les capitaux humains sont maintenus à un niveau suffisant pour répondre aux besoins actuels et futurs des organisations et des sociétés.
2. Éviter les points de rupture irréversibles
Lorsque les écosystèmes franchissent certains seuils critiques, ils risquent l’effondrement : désertification, perte de biodiversité, ou crises sociales majeures. Maintenir un bon état écologique permet de prévenir ces risques majeurs.
3. Soutenir une économie durable
Les activités économiques reposent sur des ressources naturelles et humaines. En respectant ces seuils, les organisations contribuent à préserver les bases mêmes de leur fonctionnement, évitant ainsi des coûts cachés ou futurs liés à la dégradation des écosystèmes et des communautés.
4. Favoriser la régénération et la résilience
Aller au-delà de la préservation : c’est permettre aux ressources de se régénérer et renforcer notre capacité à faire face aux crises écologiques ou économiques.
5. Garantir l’équité intergénérationnelle
Ces seuils assurent que les générations futures auront accès à des ressources et des conditions de vie similaires à celles dont nous bénéficions aujourd’hui. Ils incarnent une responsabilité collective pour un avenir durable.
Maintenir un seuil de bon état écologique est une condition indispensable pour aligner les pratiques organisationnelles sur les limites planétaires et sociales, tout en renforçant leur contribution à une économie respectueuse du vivant.
Que sont les capitaux environnementaux et sociaux selon C.A.R.E. ?
Au sens de la méthodologie C.A.R.E., les capitaux environnementaux et sociaux désignent les ressources essentielles à la prospérité des écosystèmes. Ces capitaux sont fondamentaux pour garantir un équilibre environnemental et social, et leur préservation est au cœur de la démarche C.A.R.E.
Capitaux environnementaux
Les capitaux environnementaux sont constitués des ressources naturelles et des services écosystémiques nécessaires au fonctionnement de la planète et des activités humaines. Ils incluent :
Les ressources naturelles :
Sol, eau, biodiversité, climat.
Les services écosystémiques :
Régulation du climat (ex. absorption du CO₂ par les forêts), pollinisation des cultures, cycle de l’eau, fertilité des sols, etc.
Capitaux humains
Les capitaux humains regroupent tout ce qui contribue à l’intégrité et au bien-être des individus, notamment :
• La santé,
• Les compétences et savoir-faire,
• Les moyens économiques.
Dans C.A.R.E., ces capitaux sont évalués en fonction de leur capacité à se régénérer et de leur alignement avec les seuils de bons états écologiques. Toute dégradation de ces capitaux constitue une dette écologique.